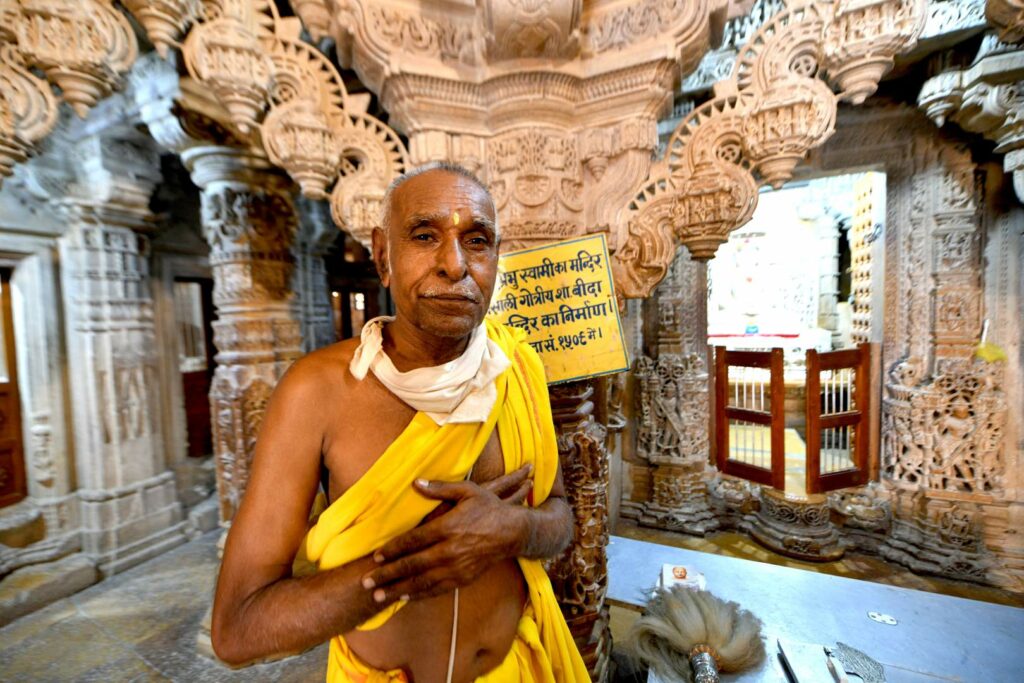Agoraphobes et misanthropes s’abstenir !… Voici l’Inde et voici Jaisalmer, une ville du désert dans le pays le plus peuplé du monde. Sa chaleur suffocante, ses imprévisibles foules de foires médiévales auxquelles il faut ajouter des animaux partout en liberté : singes, dromadaires, éléphants, vaches sacrées, paons, écureuils, chiens… Je ne vois étonnamment aucun chat, ce ne sont pourtant pas les rats qui manquent. Jaisalmer est située dans l’Etat du Rajasthan à quelques encablures du belliqueux Pakistan. C’est une petite ville fortifiée aux ruelles étroites enserrées par des remparts couleur de miel comme l’ocre du redoutable désert de Thar. Les turbans rouges, roses, jaunes et mauves des hommes font écho aux couleurs tout aussi chatoyantes des saris. Des haveli, ces hautes maisons aux façades recouvertes de dentelles de bois et de pierre témoignent d’un riche passé, quand les caravanes de chameaux sillonnaient les routes marchandes…
On a beau s’exiler dans un pays exotique, on emporte avec soi la réputation de sa terre natale. La propriétaire d’un petit hôtel perdu dans la citadelle prend un soin tout particulier à photocopier à maintes reprises mon passeport ainsi que mon numéro de visa indien, prétextant les émeutes qui secouent la France en ce début de mois de juillet.

Grand théâtre vivant
À peine débarqué je saute dans un vieux rickshaw pour Bara Bagh à 7 kilomètres de là. Ce sera ma méharée dans le désert. L’engin est manœuvré par un Indien plutôt chétif qui n’hésite pas à s’arrêter pour dépanner un collègue en panne. Ce court trajet a des allures d’odyssée, surtout quand il faut partager le macadam ramolli par la chaleur avec une chamelle et son chamelon.
Bara Bagh consiste en un ensemble de cénotaphes élevés à la mémoire d’anciens maharajas de Jaisalmer, bien avant le déferlement des Anglais. Avec ses dizaines de petits temples aux fines colonnes de grès ocre, Bara Bagh, qui veut dire Grand Jardin ressemble surtout à un grand cimetière sablonneux mais aucun humain n’y est enterré. L’endroit est plutôt isolé malgré la présence d’un jeune Indien à badge qui s’improvise guide assermenté, et un paon qui s’enfuit en me voyant arriver. Ce lieu a l’avantage de faire oublier l’agitation des villes indiennes et leur boucan infernal.
Retour à Jaisalmer par une route toute nouvelle qui se veut autoroute et que mon rickshaw-wallah prend à contresens.
Juste assez large pour le passage d’un éléphant, la porte de Krishna est l’unique accès au fort de Jaisalmer. J’y croise chaque jour un vieux musicien enturbanné tout à son instrument traditionnel à cordes. Son regard malicieux a deviné que je finirais bien un jour ou l’autre par déposer un billet de 10 roupies dans sa sébile. La belle mélodie tente de faire oublier le bruit des rickshaws et scooters, principale bande-son de l’Inde. Un grand théâtre vivant se déploie dans les rues ; une image apparaît pour disparaître aussitôt, laissant place à une autre scène, comme cet unijambiste affublé d’une prothèse antédiluvienne, et traînant au bout d’une corde son compagnon d’infortune : un cul-de-jatte assis sur une planche à roulettes.
À propos d’éléphant, en voici un aux oreilles peinturlurées qui fend la foule à travers des ruelles trop étroites pour cette montagne de viande. Dressé pour l’occasion, l’animal s’empare avec sa trompe des roupies que les gens lui tendent au passage, récupérées aussitôt par son cornac perché de guingois tout là-haut. Pour immortaliser la rencontre avec Jumbo je m’aventure à collecter quelques poils sur l’arrière-train de l’animal. Cette micro épilation ne semble pas du goût de l’éléphant qui m’envoie une puissante claque avec sa queue.
Agoraphobe ? Jamais de la vie… Je finis cependant par être lassé par ces récurrentes entrées en matière qui commencent systématiquement par un what country ? what city ? et qui n’attendent finalement aucune réponse, comme une banale formule de politesse. Selon l’humeur je réponds Transnistrie ou Colombey-les-Deux-Églises. Et à maintes reprises je suis pris à partie par de jeunes hommes enthousiastes pour être photographié, en mode selfie. « Just one pic ! ». J’en viens même à refuser l’exercice à force de me voir transformé en chair à réseaux sociaux.

un thé et du story telling
Gandhi chowk est un grand bazar qui étale sa constellation de petits commerces au pied du fort de Jaisalmer. Un Indien coiffé d’un turban violet et vêtu du traditionnel doti m’y aborde. L’homme m’invite – selon ses termes – à prendre un thé dans une chaï khana voisine, prétextant qu’il a « beaucoup de plaisir à parler aux étrangers ». Va pour un thé et un petit brin de causette ! Un inconnu est un ami qu’on n’a pas encore rencontré, me dis-je encore une fois… Khaeta, la cinquantaine bien sonnée, habite un village constitué de quelque vingt maisons habitées par une même famille de chameliers disposant de 80 bêtes, dont une dizaine dressée pour les méharées touristiques dans le désert. L’autre partie des chameaux, exclusivement les mâles, sera vendue à la grande foire annuelle des dromadaires de Pushkar… Voilà pour l’histoire personnelle. Mais si le bon bougre m’a accosté ainsi c’est parce que, confie-t-il, « si je dis d’emblée aux touristes que je propose des promenades à dos de chameau dans le désert, ils passent leur chemin », avant d’avouer : « Avec un thé et du story telling, ça marche mieux ».
Le thé, ce sera pour moi ! Son histoire de désert valait bien une poignée de roupies.
Les étrangers se font rares en Inde. Les lois sanitaires draconiennes suite au covid et l’augmentation phénoménale du prix des billets d’avion ont mis à mal les rouages de l’industrie touristique.
Je suis aussi souvent abordé par des hommes aux allures de femmes vêtus d’un sari et lourdement maquillés. Ils appartiennent à la communauté des Hijras, ces personnes considérées officiellement depuis 2014 comme un troisième sexe. Malgré cette reconnaissance de l’Etat qui permet même de mentionner ce troisième genre sur les papiers officiels, les Hijras vivent en marge de la société et se livrent souvent à la prostitution ou à la mendicité pour survivre.

La survie heureuse
Accolée à la porte de Krishna, une vaste cour abritait jadis une prison d’une vingtaine de cellules où étaient enfermés les opposants au régime durant le Raj britannique. Le bâtiment libre d’accès a conservé toutes les cellules dans leur état originel. Je m’empêtre les cheveux dans les toiles d’araignées. Après la prison, l’école… Une partie du bâtiment servit durant plusieurs décennies d’école primaire. Les enfants ont quitté les lieux en 2019 pour laisser place à un bureau du gouvernement. J’y fais la connaissance d’Amit, le comptable qui jette un peu de lumière sur ce sombre lieu.
Conscient de la pauvreté et du manque d’éducation des femmes en milieu rural, l’État du Rajasthan met en place en 2010 un organisme public dont la mission consiste à aider les villageoises dans leur quête d’autonomie sous forme de conseils juridiques et de prêts financiers. Investir dans une ou plusieurs vaches c’est se donner la possibilité de créer un petit commerce de lait et de fromage. Dans l’une des anciennes cellules, des cahiers de comptabilité attendent d’être distribués aux candidates à l’auto-entreprise.
Avec son milliard quatre cents millions d’habitants, l’Inde s’est hissée en tête des pays les plus peuplés du monde. Et moi et moi et moi, petit grain de riz insignifiant jeté dans ce chaudron démographique… De cette nation on nous livre souvent depuis l’Occident l’image d’un pays “émergent”, d’une grande démocratie à l’économie florissante, avec ses jeunes et flamboyants princes de la finance, ingénieurs aux avant-postes de la révolution numérique, ou fils de maharajas vivant dans les quartiers les plus chics de Bombay.
Pourtant, en près de vingt séjours dans ce pays fascinant je continue de rencontrer des employés dont les salaires mensuels dépassent à peine les 150 €, sans compter une majorité de gens pratiquant diverses activités informelles pour survivre.
« Tu fais quoi dans la vie ? » ; « Réparateur d’agrafeuses et de tampons encreurs ». « Et toi ? » ; « Aiguiseur de couteaux ».
Des petits métiers, il en existe une flopée dans les rues de l’Inde. Et les arracheurs de dents sont une réalité. Tout contre le mur d’enceinte, où il a installé sa chaise en bois, un dentiste non conventionné tire sur la dent d’un client à l’aide d’un fil de fer enroulé au niveau de la racine. Il se penche ensuite sur sa valise pour y dégotter une prothèse approximative. La victime, tout sourire, reste impassible…
Plus loin à même le sol, une jeune femme souffre le martyre sous l’aiguille d’un très jeune tatoueur qui lui injecte de l’encre au niveau de la cheville, en suivant le modèle dessiné sur un bout de papier. Le matériel est des plus sommaires : une batterie de moto posée à terre et reliée par des câbles électriques à une pointe qui a tout d’une arme de torture.
Comme me le fait remarquer en anglais le patron d’un petit hôtel, vendeur de lait durant sa jeunesse, reconnaissant de son bon karma : « La grande majorité des Indiens ont appris à vivre bien avec très peu. Nous appelons cela le Happy survival ».
La survie heureuse… Une nouvelle aventure pour le vingt-et-unième siècle ?